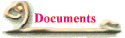|
Une lettre prémonitoire.... |
|---|
|
Lettre.... Lettre écrite par M. le Comte de Cagliostro à M. N… (1786) (*) « Je vous écris de Londres, mon cher N… Ma santé est bonne ; celle de ma femme aussi. Vous avez su les détails de ma route. Que de scènes touchantes ! Il sembloit que mes amis m’eussent devancé partout. Boulogne a mis le comble. Tout ce bon peuple sur le rivage, les bras tendus vers mon paquebot, m’appelant, s’écriant, me comblant de bénédictions et me demandant la mienne !… Quel souvenir ! Souvenir cher et cruel ! On m’a donc chassé de France ! On a trompé le roi ! Les rois sont bien à plaindre d’avoir de tels ministres. J’entends parler du baron de Breteuil, de mon persécuteur. Qu’ai-je fait à cet homme ? de quoi m’accuse-t-il ? d’être aimé du cardinal ? de l’aimer à mon tour ? de ne l’avoir pas abandonné, d’avoir de bons amis partout où j’ai passé ? de chercher la vérité, de la dire, de la défendre, quand Dieu m’en donne l’ordre en m’en donnant l’occasion ? de secourir, de soulager, de consoler l’humanité souffrante par mes aumônes, par mes remèdes, par mes conseils ? Voilà pourtant tous mes crimes ! M’en fait-il un de ma requête d’atténuation ? Cela m’est revenu. Singulière défaite ! Mais avais-je présenté cette requête, lorsque, voyant mon buste chez le cardinal, il dit, avec colère entre ses dents : « On voit partout cette figure : il faut que cela finisse ; cela finira ! » Mon courage l’a, dit-on irrité ; il ne peut digérer qu’un homme dans les fers, qu’un étranger sous les verrous de la Bastille, sous sa puissance, à lui, digne ministre de cette horrible prison, ait élevé la voix, comme je l’ai fait, pour le faire connaître, lui, ses principes, ses agents, ses créatures, aux tribunaux françois, à la nation, au roi, à toute l’Europe. J’avoue que ma conduite a dû l’étonner ; mais, enfin, j’ai pris le ton qui m’appartenoit. Je suis bien persuadé que cet homme, à la Bastille, ne prendroit pas le même. Au reste, mon ami, tirez-moi d’un doute. Le roi m’a chassé de son royaume mais il ne m’a pas entendu. Est-ce ainsi que s’expédient en France, toutes les lettres de cachet ? Si cela est, je plains vos concitoyens, surtout aussi longtemps que le baron de Breteuil aura ce dangereux département. Quoi, mon ami ! vos personnes, vos biens sont à la merci de cet homme tout seul ? Il peut impunément tromper le roi ? Il peut, sur des exposés calomnieux, et jamais contredits, surprendre, expédier, et faire exécuter par des hommes qui lui ressemblent, ou se donner l’affreux plaisir d’exécuter lui-même des ordres rigoureux qui plongent l’innocent dans un cachot et livrent sa maison au pillage ? J’ose dire que cet abus déplorable mérite toute l’attention du roi. Me trompé-je ? Oublions ma propre cause, parlons en général. Quand le roi signe une lettre d’exil ou d’emprisonnement, il a jugé le malheureux sur qui va tomber sa rigueur toute puissante. Mais sur quoi a-t-il jugé ? Sur le rapport de son ministre, sur quoi s’est-il fondé ? Sur des plaintes inconnues, sur des informations ténébreuses qui ne sont jamais communiquées ; quelquefois même sur de simples rumeurs, sur des bruits calomnieux semés par la haine et recueillis par l’envie. La victime est frappée sans savoir d’où le coup part ; heureuse, si le ministre qui l’immole n’est pas son ennemi ! Je le demande, sont-ce là des caractères d’un jugement ? Et, si vos lettres de cachet ne sont pas au moins des jugements privés, que sont-elles donc ? Je crois que ces réflexions, présentées au roi, le toucheraient. Que serait-ce s’il entroit dans le détail des maux que sa rigueur occasionne ? Toutes les prisons d’Etat ressemblent-elles à la Bastille ? Vous n’avez pas idée des horreurs de celle-ci : la cynique impudence, l’odieux mensonge, la fausse piété, l’ironie amère, la cruauté sans frein, l’injustice et la mort y tiennent leur empire ; le silence barbare est le moindre des crimes qui s’y commettent. J’étois depuis six mois à quinze pieds de ma femme, et l’ignorais : d’autres y sont ensevelis depuis trente ans, réputés morts, malheureux de ne pas l’être, n’ayant, comme les damnés de Milton, de jour dans leur abyme que ce qu’il leur en faut pour apercevoir l’impénétrable épaisseur des ténèbres qui les enveloppent ; ils seroient seuls dans l’univers si l’Eternel n’existoit pas, ce Dieu bon et vraiment tout-puissant, qui leur fera justice, un jour, à défaut des hommes. Oui, mon ami, je l’ai dit captif, et libre je le répète, il n’est point de crime qui ne soit expié par six mois de Bastille. On prétend qu’il n’y manque ni questionnaires ni bourreaux ; je n’ai pas de peine à le croire. Quelqu’un me demandoit si je retournerois en France, dans le cas où les défenses qui m’en écartent seroient levées. Assurément, ai-je répondu, pourvu que la Bastille soit devenue une promenade publique. Dieu le veuille ! Vous avez tout ce qu’il faut pour être heureux, vous autres François : sol fécond, doux climat, bon cœur, gaieté charmante, du génie et des grâces, propres à tout, sans égaux dans l’art de plaire, sans maître dans les autres ; il ne vous manque, mes bons amis, qu’un petit point, c’est d’être sûrs de coucher dans vos lits quand vous êtes irréprochables. Mais l’honneur ! mais les familles ! Les lettres de cachet sont un mal nécessaire… Que vous êtes simples ! On vous berce avec des contes. Des gens instruits m’ont assuré que la réclamation d’une famille étoit souvent moins efficace pour obtenir un ordre, que la haine d’un commis ou le crédit d’une femme infidèle. L’honneur des familles ! Quoi ! vous pensez que toute une famille est déshonorée par le supplice d’un de ses membres ! Quelle pitié ! Mes nouveaux hôtes pensent un peu différemment ; changez d’opinion, enfin, et méritez la liberté par la raison. Il est digne de vos parlements de travailler à cette heureuse révolution. Elle n’est difficile que pour les âmes faibles. Qu’elle soit bien préparée, voilà tout le secret : qu’ils ne brusquent rien ; ils ont pour eux l’intérêt bien entendu du peuple, du roi, de sa maison ; qu’ils aient aussi le Temps, le Temps premier ministre de la Vérité ; le Temps, par qui s’étendent et s’affermissent les racines du bien comme du mal ; du courage, de la patience, de la force du lion, de la prudence de l’éléphant, la simplicité de la colombe, et cette révolution, si nécessaire, sera pacifique, condition sans laquelle il ne faut pas y penser. Alors, vous devrez à vos magistrats un bonheur dont n’a joui aucun peuple connu, celui de recouvrer votre liberté sans coup férir. Oui, mon ami, je l’annonce, il règnera sur vous un prince qui mettra sa gloire à l’abolition des lettres de cachet, à la convocation de vos états généraux et surtout au rétablissement de la vraie religion. Il sentira, ce prince aimé du ciel, que l’abus du pouvoir est destructif, à la longue, du pouvoir même : il ne se contentera pas d’être le premier de ses ministres, il voudra devenir le premier des François. Heureux le roi qui portera cet édit mémorable ! heureux le chancelier qui le signera ! Heureux le Parlement qui le vérifiera ! Que dis-je, mon ami, les temps sont peut-être arrivés : il est certain, du moins, que votre souverain est propre à ce grand œuvre. Je sais qu’il y travailleroit, s’il n’écoutoit que son cœur : sa rigueur à mon égard ne m’aveugle pas sur ses vertus. Adieu, mon ami ; que dit-on du Mémoire ? La dernière lecture que Thilorier (**) m’en a faite à Saint-Denis m’a causé bien des plaisirs : a-t-il su les détails de Boulogne à tenir pour en faire un article ? Ce mémoire est-il public ? Il doit l’être. Bonsoir, parlez de nous à tous nos amis ; dites-leur qu’ils nous seront présents partout : demandez à d’Esprémesnil s’il m’a oublié ; je n’ai point de ses nouvelles. Adieu, adieu, mon bon ami, mes bons et vrais amis ; c’est à vous que je m’adresse, pensez à nous ; que cette lettre vous soit commune ; nous vous aimons tous de tout notre cœur. » (*) = Ce texte fut publié à l’époque par les principales « gazettes » d’Europe ; (**) = Avocat de Cagliostro. |

Copyright (c) 2003 Cercle Cagliostro. Tous droits réservés.
CercleCagliostro@aol.com